Ouverture de la saison à l’Opéra national de Hanovre : avec une nouvelle production acclamée de l’opéra pour la paix de Philip Glass, Daniel Kramer passe au crible la capacité du Mahatma Gandhi à se projeter dans l’avenir. La scène et la direction des personnages impressionnent par la finesse de leur interprétation, jusque dans les moindres détails.
Guerre et paix, bouleversement ou résistance : « Satyagraha », en français « Fidélité à la vérité », a posé en Afrique du Sud la première pierre du mouvement pour la liberté de Gandhi qui, avec la désobéissance civile et la résistance non violente, a finalement signifié, comme on le sait, l’indépendance de l’Inde vis-à-vis de la domination coloniale britannique.
Dans son opéra créé en 1980, qui forme avec « Einstein on the beach » et « Akhnaten » la trilogie des portraits du pharaon hérétique de l’Egypte ancienne Akhenaton, Philipp Glass s’est penché sur l’action précoce de ce combattant de la liberté assassiné en 1948.

L’œuvre est bien plus qu’une succession chronologique et une description de l’activité de Gandhi : le livret en sanskrit de l’Inde ancienne est déjà clairement basé sur la « Bhagavad Gita », cet écrit fondateur de l’hindouisme issu de l’épopée nationale mythique « Mahabharatha ». Cet opéra est donc un jeu de mystères religieux qui veut sonder, au-delà de l’espace et du temps, l’essence et la raison d’être de l’action de Gandhi. Et cela ne peut se faire que sans la succession chronologique de scènes de la vie de Gandhi. Le « Satyagraha » de Glass se présente ainsi également comme un développement détaché d’un « festival de dédicaces scéniques ». Avec sa réduction continue et encore plus rigoureuse des moyens stylistiques, comme ceux qui servaient déjà à Richard Wagner dans son « Parsifal » comme moyen de parvenir à une religiosité quelconque, Glass réussit simplement et directement une pièce de méditation d’une grande force d’attraction.
La discontinuité de la chronologie n’est pas seulement soutenue par la « musique minimaliste », sans cuivres ni percussions, qui s’apparente à un mantra et à un flot spirituel, mais aussi par le fait que les trois actes sont nommés d’après des modèles de Gandhi. Léon Tolstoï, Rabindranath Tagore et Martin Luther King donnent un sens aux différents actes, ce qui n’empêche pas le metteur en scène américain Daniel Kramer de développer sa pensée de mise en scène en se détachant des grands noms.
De grands films comme « 2001 – L’Odyssée de l’espace » se déroulent déjà au-delà de l’infini : Kramer fait varier l’idéologie de Gandhi au fil des actes, dans le futur et hors de la Terre, dans l’espace. Dans le décor de Justin Nardella, au début du premier acte, Gandhi, Krishna et Arjuna flottent depuis le haut de la scène pour débattre du pour et du contre de la résistance violente. Arjuna (Darwin Prakash au baryton coulant) est tout à fait belliqueux avec des cornes rouges de diable et un fusil Kalachnikov doré qui apparaît d’abord comme une guitare hippie de l’époque des anciens soixante-huitards avec une référence à l’Inde (costumes Shalva Nikvashvili). Le Krishna apporte des fleurs en plastique pacificatrices (Markus Suihonen avec sa basse ronde), mais le flower power n’est plus : le chœur et les vidéos (Chris Kondek) thématisent en arrière-plan l’éternel retour des mêmes guerres, et Gandhi est abattu. En lettres géantes, « Gandhi assassiné » s’affiche au-dessus de la scène, tandis que Gandhi est pleuré sur sa civière. S’ensuit la première réincarnation du Satyagraha dans le design pelucheux du Livre de la jungle à l’époque de la domination britannique en Inde. Mais les conditions paradisiaques autour des gentils animaux en peluche autour de la panthère noire Baghira & co., apportées par le chœur, ne sont qu’une apparence : après tout, l’auteur du Livre de la jungle, Rudyard Kipling, était colonialiste jusqu’au bout des ongles. La mise en scène montre ces ambiguïtés avec des clins d’œil et des larmes. Ainsi, l’image du Livre de la jungle se transforme en une image avec toutes sortes de champignons de la drogue, qui étaient très en vogue à l’époque des hippies.
Dans le deuxième acte, la civilisation est déjà presque terminée. Nous sommes en 2048 et, au milieu d’énormes tas de ferraille, une société bercée par des promesses de salut se morfond dans l’espoir d’une rédemption. De manière merveilleusement hypocrite, les faux prédicateurs se présentent en robe blanche de réveil avec une auréole et font miroiter à la communauté les hashtags #sustainable, #yourfuture, #the_solution et #bonvoyage (projetés en lettres sur l’arrière-plan) comme remède. Le greenwashing nous salue : tandis que des distributeurs d’eau prometteurs sont distribués, les prédicateurs de salut eux-mêmes se préparent déjà à aller sur la lune. La femme rousse de Gandhi, Kasturbai, ose se révolter et est abattue. Beatriz Miranda joue et chante cela avec une grande intensité et une mezzo chaude et fluide.
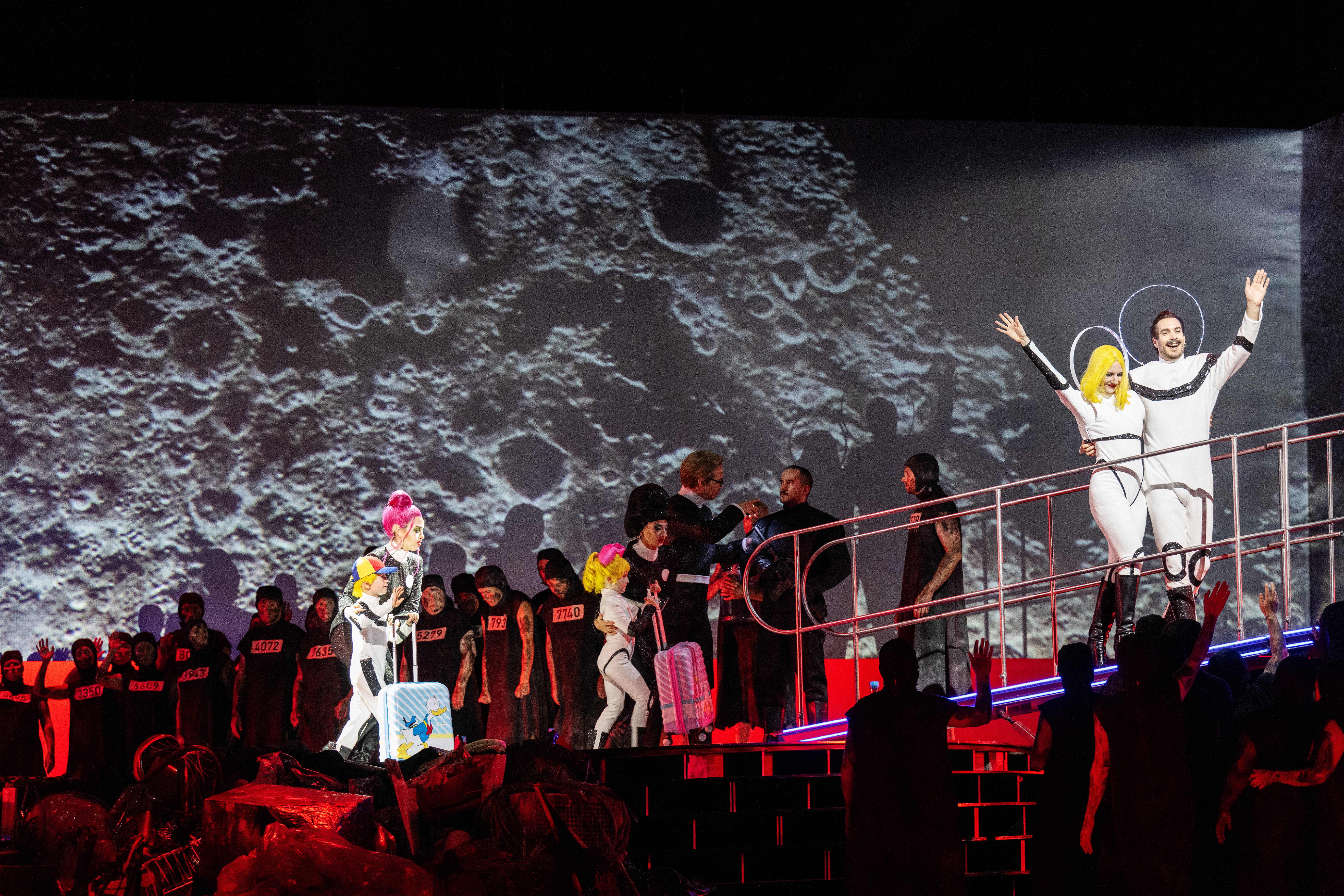
La dystopie est poursuivie de manière conséquente dans le troisième acte : la vidéo montre un dernier vol au-dessus de la Terre en 3048. C’est un état originel sans humains, qui montre à nouveau le début au-delà de l’infini, quelque part au milieu de nulle part. Devant des vidéos de division cellulaire, des amibes veloutées aux trois couleurs de peluche surgissent de la scène et fraternisent. C’est à la limite du kitsch, et Gandhi fait son apparition. L’arrière-plan ouvre la vue sur la technique de l’espace scénique, tandis que la salle de spectacle est éclairée.
Gandhi est-il maintenant prêt pour l’avenir ? Avec la fin qui s’achève sur une musique de méditation, la mise en scène ne fournit pas non plus de réponse claire. Gandhi remet ainsi aux hommes un cahier d’actions assez indécis. Ce qui suit ne peut être que l’éternel retour du même. L’issue semble différente. La manière dont Daniel Kramer traite cette question est néanmoins une réponse à la critique faite au compositeur, selon laquelle son opéra propagerait une théorie naïve de la paix. Et ce, bien que de nombreux petits détails de la mise en scène permettent de prendre clairement position, la question de la « guerre » ou de la « paix », si urgente aujourd’hui, reste finalement sans réponse.
Dans le rôle principal de Gandhi , Shanul Sharma convainc par son jeu authentique et sa capacité d’expression nuancée et variée. Son ténor est parfois fade, puis il sait passer à une intonation dramatique et expansive pour pouvoir marquer des points dans les passages tendres et méditatifs.

Le chœur, préparé par Lorenzo Da Rio, agit de manière nuancée et précise, tant au niveau du chant que du jeu d’acteur. L’orchestre d’État de Hanovre est guidé avec attention et clarté par Masaru Kumakura à travers le tapis musical des mantras, qui n’est pas du tout simple et monotone, mais qui sait justement déployer un effet particulier grâce aux variantes et aux retours, aux doubles et aux retards. On aurait seulement souhaité un peu plus de précision dans les accords avec le chœur.
Au final, tous les participants sont acclamés pour ce début de saison particulièrement réussi, car d’une grande qualité artisanale et pensé jusque dans les moindres détails.